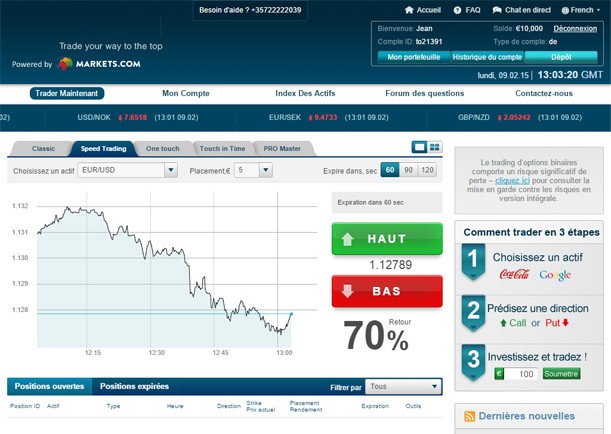Le recours aux heures supplémentaires indique généralement que l’entreprise tourne à plein régime. Travailler en dehors du temps normal apporte des avantages, tant pour la société que les employés. Ce sera le cas, à condition que les parties soient complètement d’accord sur les détails, notamment concernant le volume horaire mensuel. Voici un rappel des règles élémentaires pour que les heures sup soient bénéfiques pour tout le monde.
Un rappel sur la définition des heures supplémentaires
 Toutes les heures travaillées en dehors du temps réglementaire sont considérées comme heures supplémentaires. En France, le volume horaire hebdomadaire est de 35 h, mais certaines professions le dépassent. La comptabilisation des heures de travail de chaque employé se fait annuellement. La somme des temps de présence, ou contingent, atteint généralement 1607 heures par an. L’entreprise peut les dépasser à hauteur de 220 h au maximum. Quoi qu’il en soit, une heure supplémentaire se fera par demande de l’employeur. Ce dernier sera en mesure de juger si le travail à accomplir demande à ce que son personnel reste un peu plus longtemps que d’habitude. Les heures sup concernent exclusivement les employés qui travaillent à temps plein dans une société. En principe, elles doivent avoir l’aval des concernés, le délégué du personnel ou le comité d’entreprise. Les travailleurs à mi-temps et les intérimaires en sont exclus, même si des arrangements peuvent toujours avoir lieu. Les cadres dirigeants, qui ont souvent une obligation de résultat, ne font pas d’heures supplémentaires. S’ils restent tard, c’est souvent volontaire. Il arrive parfois que les cadres non dirigeants reçoivent une compensation similaire aux heures supplémentaires s’ils travaillent plus de 217 jours par an. Le plafond annuel est fixé à 282 jours travaillés pour éviter tout excès de zèle. Toute la difficulté repose sur le fait que la plupart des cadres continuent de travailler depuis chez eux ou pendant le trajet qui mène au bureau. La comptabilisation devient compliquée. Grâce à la loi TEPA, le recours aux heures sup peut donner lieu à un allègement de la charge fiscale de la société, en l’occurrence la cotisation patronale. Les employés bénéficient également des mêmes privilèges. Pour cause, les heures supplémentaires font l’objet d’exonération fiscale. Un décret daté du 4 octobre 2007 donne les détails sur cette défiscalisation. Cet avantage concerne essentiellement les employés de la fonction publique.
Toutes les heures travaillées en dehors du temps réglementaire sont considérées comme heures supplémentaires. En France, le volume horaire hebdomadaire est de 35 h, mais certaines professions le dépassent. La comptabilisation des heures de travail de chaque employé se fait annuellement. La somme des temps de présence, ou contingent, atteint généralement 1607 heures par an. L’entreprise peut les dépasser à hauteur de 220 h au maximum. Quoi qu’il en soit, une heure supplémentaire se fera par demande de l’employeur. Ce dernier sera en mesure de juger si le travail à accomplir demande à ce que son personnel reste un peu plus longtemps que d’habitude. Les heures sup concernent exclusivement les employés qui travaillent à temps plein dans une société. En principe, elles doivent avoir l’aval des concernés, le délégué du personnel ou le comité d’entreprise. Les travailleurs à mi-temps et les intérimaires en sont exclus, même si des arrangements peuvent toujours avoir lieu. Les cadres dirigeants, qui ont souvent une obligation de résultat, ne font pas d’heures supplémentaires. S’ils restent tard, c’est souvent volontaire. Il arrive parfois que les cadres non dirigeants reçoivent une compensation similaire aux heures supplémentaires s’ils travaillent plus de 217 jours par an. Le plafond annuel est fixé à 282 jours travaillés pour éviter tout excès de zèle. Toute la difficulté repose sur le fait que la plupart des cadres continuent de travailler depuis chez eux ou pendant le trajet qui mène au bureau. La comptabilisation devient compliquée. Grâce à la loi TEPA, le recours aux heures sup peut donner lieu à un allègement de la charge fiscale de la société, en l’occurrence la cotisation patronale. Les employés bénéficient également des mêmes privilèges. Pour cause, les heures supplémentaires font l’objet d’exonération fiscale. Un décret daté du 4 octobre 2007 donne les détails sur cette défiscalisation. Cet avantage concerne essentiellement les employés de la fonction publique.
L’obligation de majoration et de compensation
Toutes heures dépassant les 35h réglementaires sont majorées. La loi impose une majoration de 25% pour les huit premières heures. En dehors de cette limite, le calcul dépasse généralement les 50%. Ce sera même 100% en cas d’heures sup effectuées en jour férié. Les entreprises déterminent à l’avance le taux de majoration qui reste flexible. Par ailleurs, le recours aux heures supplémentaires ne doit en aucun cas contredire le contenu du contrat du travail. Ce sera une mesure ponctuelle qui devrait uniquement être prise en cas de hausse de production. De toute manière, l’employé doit être informé à l’avance qu’il aura à rester plus longtemps que prévu dans l’entreprise. C’est à l’employeur de gérer le temps de travail de façon à accorder un repos suffisant. Autrement dit, il sera impossible de retenir un employé 24 heures d’affilé. Il lui faut des heures de sommeil entre deux journées chargées. Certains travaux urgents ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Dans ce cas, le système de compensation sera plus adapté. Par exemple, la personne qui était restée deux heures de plus le lundi pourra venir un peu plus tard au bureau le mardi ou rentrer plus tôt le vendredi. Cependant, cette situation doit être exceptionnelle, sauf si le contrat prévoit une flexibilité des horaires de travail. Dans l’Hexagone, trois secteurs d’activités se considèrent comme les champions nationaux des heures sup. Les employés de l’hôtellerie sont les premiers à travailler plus que prévu avec un dépassement hebdomadaire de 22,2h. Les ouvriers du bâtiment et le personnel des transports connaissent aussi un rayon. Ils effectueraient en moyenne entre 19,8h et 20h d’heures supplémentaires par semaine. Les employés sont les premiers bénéficiaires des heures supplémentaires. La majoration (25% ou 50%) leur permettra d’arrondir leur paie à la fin du mois. L’entrepreneur tire également profit des dépassements. Les commandes seront expédiées à temps. Ainsi, l’entreprise gagne en compétitivité.
En cas de refus de l’employé ou d’autres problèmes
 De façon générale, un employé n’a pas le droit de refuser d’accomplir des heures supplémentaires si l’entreprise le lui demande. Le refus constituera un motif de sanction et compte notamment pour de l’insubordination. Inversement, un salarié ne pourra pas non plus décider d’effectuer des heures sup sans l’aval de la direction. Il peut rester plus longtemps pour finir le travail qu’il doit accomplir, sans pour autant réclamer un paiement. Dans certaines situations, les employés peuvent faire des heures supplémentaires et apporter des justifications sur les motifs des dépassements. En cas de litige, c’est la loi du 21 août 2008 qui doit servir de référence. Ce texte légal délimite notamment les situations pour lesquelles l’Inspection de travail doit être saisie. La législation française encourage les parties à fixer à l’avance les détails des heures supplémentaires. En effet, c’est loin d’être généralisé. Des paramètres tels que le rythme de travail de l’entreprise, la flexibilité horaire ou le contenu du contrat signé par les employés entrent en compte. La taille de la société est également à voir. Le comité d’entreprise aura alors son mot à dire sur le sujet. En cas d’absence de cette entité consultative, les délégués du personnel doivent être entendus. L’employé qui se sent lésé par un refus de paiement des heures sup peut saisir le tribunal de première instance. Il fournira au juge des preuves sur sa présence dans les locaux de l’entreprise ou son poste itinérant. Ce plaideur doit aussi apporter des motifs justifiant le dépassement des 35h réglementaires. Ce sont notamment des bons de commande, des courriels ou d’autres pièces. Dans certains cas, il faut attendre la fin de l’année pour voir si le volume horaire annuel dépasse effectivement le contingent de 1607h. L’employé disposera alors de trois ans pour porter l’affaire en justice.
De façon générale, un employé n’a pas le droit de refuser d’accomplir des heures supplémentaires si l’entreprise le lui demande. Le refus constituera un motif de sanction et compte notamment pour de l’insubordination. Inversement, un salarié ne pourra pas non plus décider d’effectuer des heures sup sans l’aval de la direction. Il peut rester plus longtemps pour finir le travail qu’il doit accomplir, sans pour autant réclamer un paiement. Dans certaines situations, les employés peuvent faire des heures supplémentaires et apporter des justifications sur les motifs des dépassements. En cas de litige, c’est la loi du 21 août 2008 qui doit servir de référence. Ce texte légal délimite notamment les situations pour lesquelles l’Inspection de travail doit être saisie. La législation française encourage les parties à fixer à l’avance les détails des heures supplémentaires. En effet, c’est loin d’être généralisé. Des paramètres tels que le rythme de travail de l’entreprise, la flexibilité horaire ou le contenu du contrat signé par les employés entrent en compte. La taille de la société est également à voir. Le comité d’entreprise aura alors son mot à dire sur le sujet. En cas d’absence de cette entité consultative, les délégués du personnel doivent être entendus. L’employé qui se sent lésé par un refus de paiement des heures sup peut saisir le tribunal de première instance. Il fournira au juge des preuves sur sa présence dans les locaux de l’entreprise ou son poste itinérant. Ce plaideur doit aussi apporter des motifs justifiant le dépassement des 35h réglementaires. Ce sont notamment des bons de commande, des courriels ou d’autres pièces. Dans certains cas, il faut attendre la fin de l’année pour voir si le volume horaire annuel dépasse effectivement le contingent de 1607h. L’employé disposera alors de trois ans pour porter l’affaire en justice.